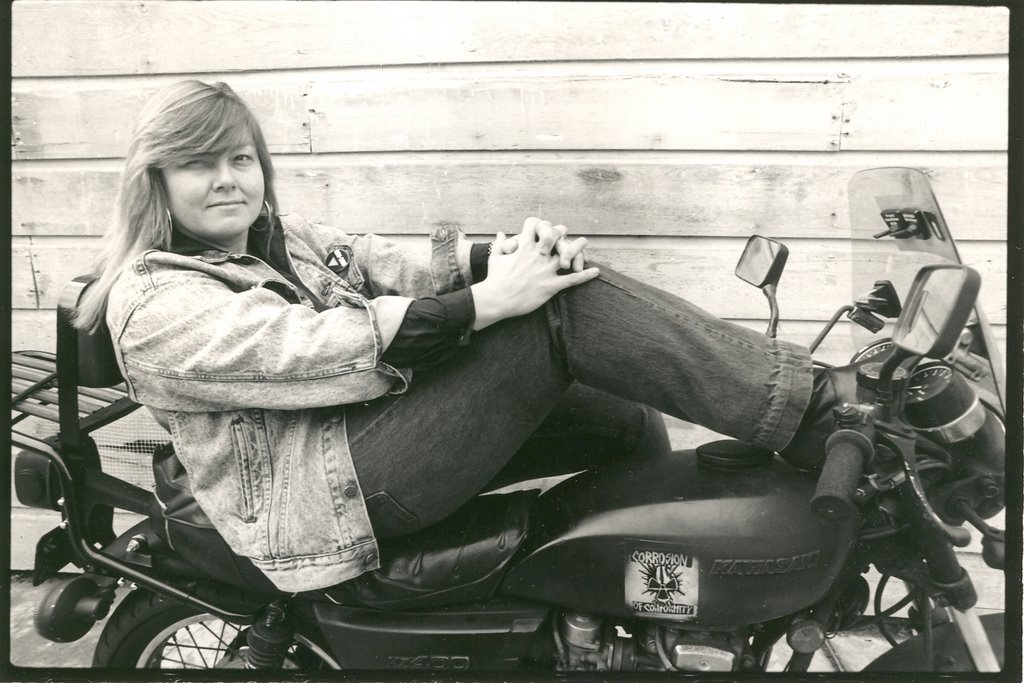Passive
extrait de Peau
Ce texte est tiré de “Peau”, paru en France aux éditions Balland, le rayon Gay.
Le titre original de ce livre paru aux États Unis est “Skin, talking about sex, class and litterature”. Il regroupe différents textes ou essais de Dorothy Allison parus dans des revues americaines.
Je suis dans ma période femme fatale, je leur dis toujours. Elles se retournent alors pour me regarder, ces femmes aux bras musclés et à l’expression indifférente - regarder mes cheveux se balançant sur mes épaules, mes boucles d’oreilles de cinq centimètres en verre, et la chaîne filigranée en argent que je porte autour du cou -, et à cette femme, elles sourient. Chacune est sûre de comprendre exactement ce que je veux dire. Je bois une gorgée de vin et je souris, en sachant qu’elles n’ont rien compris du tout, et pour une fois je m’en fiche un peu. Aucune d’elles ne prend note de la ceinture de l’armée enserrant mon short, du gros anneau en argent que je porte à l’annulaire gauche, du coup d’oeil rapide que je leur lance par-dessus mon sourire. Ce sont des femmes si polies, la plupart « politiques » d’une façon dont seules les lesbiennes d’un certain âge peuvent se réclamer. Elles ont la voix si douce qu’elles me paraissent presque non sexuelles, et la moitié de leur charme opère quand elles me prouvent que j’ai tort.
Il n’y en a pas une parmi elles qui comprenne ce que je dis vraiment lorsque j’utilise ce code, lorsque je balance mes cheveux et raconte comment je suis devenue passive.
J’avais l’habitude de m’exprimer à travers un code : « J’aime que mes femmes soient des dures. » J’étais à la librairie des femmes en train de boire de l’eau de Seltz et de me balader avant que la discussion commence. Ou à la clinique, renversée dans une chaise en plastique après une heure d’attente infructueuse pour voir un médecin. Ou sous les douches à la gym, en train de squatter en bas pour reposer mes cuisses après avoir voulu prouver à quel point j’étais résistante. Peu importe. C’était toujours la même chose, quelqu’un blaguait sur l’atmosphère printanière qui avait déclenché de nouvelles romances. Quelqu’un me regardait attentivement. Une fois, Leslie, une amie, s’est penchée au-dessus de moi et m’a poussée. « Tout est si sexuel chez toi », a-t-elle dit.
Oui, oui. Elle avait raison. J’ai toujours été comme ça - à vouloir, à avoir besoin. Mais je n’aimais pas en parler si explicitement, ni l’admettre si facilement. J’avais eu une enfance calme et une adolescence à retardement. Je n’ai eu de vie sexuelle qu’après vingt ans et j’ai alors ressenti un sentiment de privation permanent, comme si les aventures sexuelles que je n’avais pas eues étaient là, à me tenter, et n’attendaient que d’avoir lieu.
Alors j’aime les femmes dures, les femmes-mecs, grandes, sûres d’elles, fortes. J’aime tortiller, tourner et rouler mes doigts le long de leurs hanches, attirer leur vulve ouverte à ma bouche et la travailler, l’art et la manière de leur plaire. Et lorsqu’elles se tournent vers moi, j’aime crier en sentant leur peau brûlante contre la mienne. C’est là que chaque partie de moi s’ouvre et que des sons en sortent, non pas des sons de passion mais des sons de joie. De satisfaction. Satisfaction déterminée et adulte qui refuse le silence, tous les silences, en particulier le long silence de mon enfance, le refus d’une enfant lesbienne qui normalement n’aurait jamais du survivre.
J’ai grandi dans une maison pleine de contrastes. Les femmes de ma famille étaient presque toujours enceintes, et remarquablement ouvertes quand au sexe. “Il est pas à la hauteur du foutoir que c’est pour lui ôter son pantalon”, avaient-elles coutume de dire à propos d’un de mes oncles, alors que tante Dot, en l’honneur de qui mon prénom avait été choisi, avaient l’habitude de donner un coup de tête en direction d’un homme, d’écarter ses mains de dix centimètres l’une de l’autre, puis de pincer les lèvres en émettant un soupir de grande tristesse. Cela ne manquait jamais de faire rougir le monsieur et de nous faire toutes rire, même mes cousines, pourtant trop jeunes pour comprendre. Mes cousines, comme mes tantes, tombaient enceintes avec une remarquable régularité. Elles avaient quitté l’école à quatorze ou quinze ans pour s’asseoir sous le porche avec leurs ventres qui grossissaient,. et offraient leurs conseils aux plus jeunes. « Tu vas avoir à le payer, crois-moi, disaient-elles, alors tu ferais bien d’en profiter pendant que tu peux. »
Je ne voulais pas m’en priver, je voulais en profiter et ne payer que ma part, dans la tradition familiale. Mais je ne m’intéressais pas aux parties pendantes que mes cousins étaient si fiers d’exposer. J’ai su très tôt que j’étais particulière, lorsque j’ai mouillé quand une de mes cousines a mis sa main à l’intérieur de ma cuisse et m’a caressée en rigolant. J’en ai rêvé des jours après, mouillant encore plus à chaque fois.
« Seuls les garçons font des bébés, m’a dit ma cousine. Tu ne risques rien en te tripotant toute seule. Bien que tu ne devrais peut-être pas le faire autant. » Elle n’a pas dit pourquoi. Mais personne n’avait besoin de me dire pourquoi je ne devais pas mouiller en pensant à mes cousines. C’était connu. J’avais trouvé les mots dans les livres que mon beau-père cachait entre le matelas et le sommier. Les mots étaient là avec les images et la terreur. Gouines, homos, sexe. Elles me battraient et me laisseraient, me baiseraient et me détesteraient. Je finirais dans un hôpital psychiatrique, n’obtiendrais jamais de travail, serais à la charge de la famille tout le reste du temps, et, de toute façon, ne vaudrais jamais, jamais rien. Je voulais grandir et être intelligente, riche, avoir de l’éducation et être indépendante. Je voulais m’éloigner le plus possible de la vraie saleté nue qui marquait les jardins de toutes les maisons dans lesquelles nous avions vécu. Maman hochait la tête, m’encourageait, et d’une certaine manière, le long du chemin, le sexe et les jardins à l’abandon se sont confondus. Mortellement confondus.
« Elle va le payer le restant de sa vie, a dit maman quand Debbie, la cousine qui avait toujours eu l’air si sensible, a commencé à rester dehors tard le soir et à raconter des histoires cochonnes. Ça ne vaut pas le coup. Vraiment pas le coup. »
Le sexe était dangereux, un piège, la même connerie que de boire du whisky dans un gobelet en carton ou de murmurer des histoires cochonnes à trop haute voix. Le sexe était le signe le plus sûr que l’on avait rien de mieux à espérer. « Tu es différente », disait ma maman, les mains à l’arrière de ma tête, pleines d’amour, mais la voix suffisamment triste pour me briser le coeur.
« Regarde-la, disait maman. Avant que tu aies quitté le collège, ses enfants seront assez âgés pour avoir eux-mêmes des enfants. » C’était un fait. Il suffisait de quatorze années pour qu’une fille soit en âge d’avoir une fille. Ma maman n’en était-elle pas la preuve ? Vingt jours après son quinzième anniversaire, en me mettant au monde, moi, une autre petite fille ?
Je ne ferai pas ça, avais-je décidé fermement. Lorsque mes jeunes soeurs ont commencé à balancer et faire boucler leurs cheveux, je suis sortie, je me suis procurée une carte de bibliothèque, et j’ai attaché mes cheveux en arrière, lissés contre mon crâne. Je n’étais jamais sans un livre au point que cela en est devenu un sujet de plaisanterie dans la famille. Quand mes tantes racontaient des histoires cochonnes sous le porche, elles chassaient les autres enfants mais me gardaient. « Ça n’intéresse pas Dorothy », disaient-elles, alors je me voûtais un peu plus au-dessus de mon livre, faisant semblant de ne pas écouter.
Parfois elles parlaient de femmes comme moi. J’avais une tante assez sauvage qui n’avait jamais eu d’enfants, qui conduisait un camion, donnait un coup de main à mes oncles dans les hauts fourneaux, et travaillait parfois comme mécano à la base aérienne. Elle portait des bleus de travail et plaçait ses cheveux sous une casquette de paysan. Des fois mes autres tantes racontaient des histoires à son sujet, et plaisantaient sur le fait qu’elle se « desséchait ».
« Si tu t’en sers pas, tu la perds. »
Un garçon de mon cours de maths m’a dit ça un jour. Je lui ai ri au nez, en me demandant s’il pensait vraiment à lui pour m’en servir. J’en profitais tout le temps, au moins quatre fois par jour, une fois au réveil, deux fois avant de m’endormir, et dès que je pouvais être seule dans l’après-midi. J’inventais des histoires pour m’accompagner - des aventures de voyages en mer, de résistance, où j’étais attrapée et attachée en attendant mon exécution parce que je ne voulais pas trahir ma meilleure amie. J’étais membre d’une organisation secrète de jeunes filles qui vivaient dans un réseau de caves et de corridors souterrains. Il y avait une entrée creusée sous mon placard. Nous avions de merveilleuses bibliothèques, des gymnases et des piscines où nous nagions nues pour développer notre endurance. Nous faisions l’amour sur des rayonnages au-dessus de la piscine, pas les ébats rudes et gauches de mes cousins, mais de longs baisers et de soudaines accélérations qui me laissaient tremblante de bonheur dans mes draps humides.
Je me réveillais tous les matins terrifiée à l’idée que quelqu’un puisse se douter de ce que j’avais imaginé. Que m’arriverait-il à cause de ces rêves éveillés de filles entre elles ? J’ai grandi de plus en plus terrorisée. Pourtant, j’ai écrit une de ces aventures et je l’ai donnée à lire à une fille en classe qui disait qu’elle adorait mes histoires. Elle avait un visage maigre, mais ses yeux étaient d’un marron si doux que j’ai pensé pouvoir lui faire confiance. Elle a fait circuler l’histoire pendant le déjeuner, et au début de l’après midi des élèves me riaient au nez. Mon épopée incluait un combat d’épée, une fuite, des acrobaties, et finalement nous nous enfuyions en direction du bassin de l’Amazonie pour nous y bâtir une retraite. En classe de sciences, un garçon a pris la grande règle utilisée pour les cartes géographiques et a fait semblant de me transpercer le ventre.
« Eh, mec ! » a-t-il hurlé, et tout le monde a rigolé. Ils l’avaient tous lue. J’ai tenu jusqu’à la fin des cours, mais je ne suis pas retournée à l’école pendant deux jours. Je suis restée au lit, fiévreuse. « Un rhume de printemps », a dit maman.
« Me dessécher », me répétais-je, allongée sans bouger, ne me touchant pas, ne me laissant plus m’inventer d’histoires. Je m’en suis voulu d’être différente.
J’étais différente.
J’étais différente. Je n’en avais pas besoin.
Je ne me suis rien fait pendant un an. Froide, sèche, ne me touchant pas. Lorsque je me réveillais mouillant et ayant mal, je m’étendais, rigide, en fixant l’obscurité jusqu’à ce que des boules de lumière bougent au-delà du plafond. Je lisais plus que jamais, j’ai développé ce que maman appelait un langage châtié, j’ai été prise d’insomnies aussi. Si je ne pouvais pas dormir sans, alors je ne dormirais pas.
C’est l’année où grand-mère m’a dit que quelqu’un avait tué ma tante excentrique. On avait retrouvé son camion sorti de la route, et elle dans le fossé, sans son bleu de travail. L’histoire ne s’arrêtait pas là, mais grand-mère n’a rien voulu dire de plus, même pas à moi. Pas à moi en particulier ? Je me suis posé la question. Mais bien sûr, j’ai su. Elle avait été violée. Mes oncles n’étaient pas aussi prévenants que grand-mère, et quelque part je savais que l’histoire contenait plus d’éléments que cela, qu’elle était plus qu’un simple meurtre. Si tu ne le faisais pas avec les garçons, ils te le feraient, d’une façon si terrible que les hommes hésitaient à en répéter les détails.
Pas juste décalée, non, le mal. J’étais le mal, dangereuse pour moi-même et pour le monde. Alors j’ai amassé tout ce que je trouvais sur des femmes qui étaient le mal, des histoires, des livres, l’histoire aussi, je suis tombée amoureuse d’Elisabeth I qui brûlait ses ennemis, de la sombre reine de France qui les empoisonnait, de la gitane dans l’histoire de la Reine Neige qui portait un couteau et savait s’en servir, et d’une cousine grande gueule qui avait une ligne de cicatrices à chaque poignet. Des sorcières, des mares noires et obscures, de la résistance. Dans une histoire imaginaire, des filles apaches sortaient dans le désert pour s’étendre, leurs vulves exposées face à la lune. J’ai ouvert toutes les fenêtres et je me suis allongée sur le sol en bois, là où mes soeurs ne pouvaient pas me voir, et m’en souciant peu. La fièvre est montée en moi, la chaleur a gagné ma gorge. La lune battait comme un coeur dans la chambre. En la regardant, je pouvais dessiner les contours de son visage, un lys dans le cercle clair et brûlant. Je me suis baissée et j’ai entouré mon sexe de mes mains, mes doigts se déplaçaient là où ils n’étaient pas allés depuis longtemps, un petit cri de douleur a résonné dans mon ventre.
Du sexe là, sans souci du danger. Du sexe maintenant, à n’importe quel prix. Plus jamais, me suis-je promis, je ne laisserai quelqu’un me conduire à me priver de moi-même. Je me suis retournée de façon que mes hanches puissent se balancer contre le bois rugueux, pour que mes articulations râpent et appuient, et que ma bouche respire la chaleur de la terré et du bois. Je me suis raconté une histoire qui commençait avec ma tante, derrière la porte, partant pour le bassin d’Amazonie, et se retournant pour m’appeler d’une voix forte. Une femme est entrée alors, une grande femme au regard lourd, sombre et aux mains aussi puissantes que les miennes. J’ai ondulé contre le bois et je lui ai raconté une histoire, j’ai juré en son nom et j’ai ri lorsqu’elle est venue - légère comme le clair de lune, massive comme la nuit - s’allonger et coller sa peau à la mienne.
Je peux écrire sur des années en un seul paragraphe, mais les années ont mis des années à s’écouler. J’ai passé mille ans à être une petite fille, frappant sur mes propres cuisses et maudissant ma vie, parce que j’étais la nièce de mes tantes, l’enfant de la famille, et une lesbienne qui avait du mal à se faire aimer correctement. Je voulais une opération, pas celle qui consistait à devenir un homme, non, une opération qui aurait placé un levier dans ma chair, un interrupteur que j’aurais pu laisser éteint en permanence. J’avais très envie d’immunité, de distance, de soulagement - pas la fin de tout le sexe, mais la fin du besoin, et plus que de la chair, la fin du besoin d’amour -, ses mains placées sans crainte dans les miennes, son regard chaleureux, brun et digne de confiance. Avoir besoin d’une femme est un besoin impérieux, nécessaire, facilement refusé mais jamais nié complètement. Mes besoins de femmes ont été constants, dévorants, et puissants. Leurs besoins de moi ont été tout aussi puissants, insistants et, Dieu merci, aussi impossibles à nier.
Comment était-ce d’être lesbienne avant le mouvement pour les femmes ? C’était avoir le penchant le plus dangereux, risquer sa perte, braver les plus terribles conséquences. La lune ne suffisait pas, trop d’entre nous se haïssaient et avaient peur de leur désir. Mais lorsque nous nous sommes trouvées les unes et les autres, nous avons accompli des miracles - miracles d’espoir, de défi et d’amour. Voilà l’histoire qui met des années à être racontée, ma main dans les siennes et ses yeux confiants, défaire ses cheveux et apprendre à danser à trente ans, emprunter et traduire toutes les vieilles histoires de mes tantes, ne pas parler en code, juste mettre à terre ces filles butch.
Tout est si sexuel pour moi. Tout tient du miracle. J’ai quarante-quatre ans, j’ai vieilli à l’image de ce que je voulais être - pressante, saisissante, sexuelle et surprenante. J’aime utiliser contre moi-même les gros mots que mes tantes utilisaient sous leurs porches. J’aime faire scandale et le raconter après, faire rire les femmes nerveuses et rendre nerveuses les femmes qui rient. Je ne suis jamais discrète, je ne suis jamais celle que l’on attend. J’ai toujours aimé ces filles dures, ces femmes qui allient silence et puissance, mais j’en suis encore à m’épanouir, encore à ma longue adolescence attardée, à ma période passive, et seulement cinquante pour cent de mon esprit pour dire ce que je sais.
C’est ça le code.
J’ai l’ambition d’incarner mon propre fantasme d’adolescente, de comprendre ces légendes de science-fiction et de revenir à la petite fille que j’étais. Je veux apparaître sortant d’un lotus éclairé par la lune, la trouver, à douze ans, sur un sol en bois dur, me baisser et prendre ses mains, la relever et lui raconter l’histoire qu’elle n’a pas encore vécue. Ma vie, sa vie, la vie d’une lesbienne qui a appris la valeur et le prix du sexe. Je veux l’appeler Petite Soeur et rire d’un rire qu’elle reconnaîtrait. Dis, le sexe c’est délicieux. Le sexe c’est le pouvoir. Ne prétends jamais que tu ne veux pas de pouvoir dans ta vie. Le sexe.
Je vais me rendre là-bas d’une façon ou d’une autre, je balancerai mes cheveux et je promettrai à cette jeune moi-même que la lutte vaut le coup.
« Ma fille, je veux lui dire. Accroche-toi, ma chérie. Tu vas aimer ça. Ça va valoir le prix, ça vaudra la peine de se battre. Petite, je veux lui dire, tu vas être heureuse. »